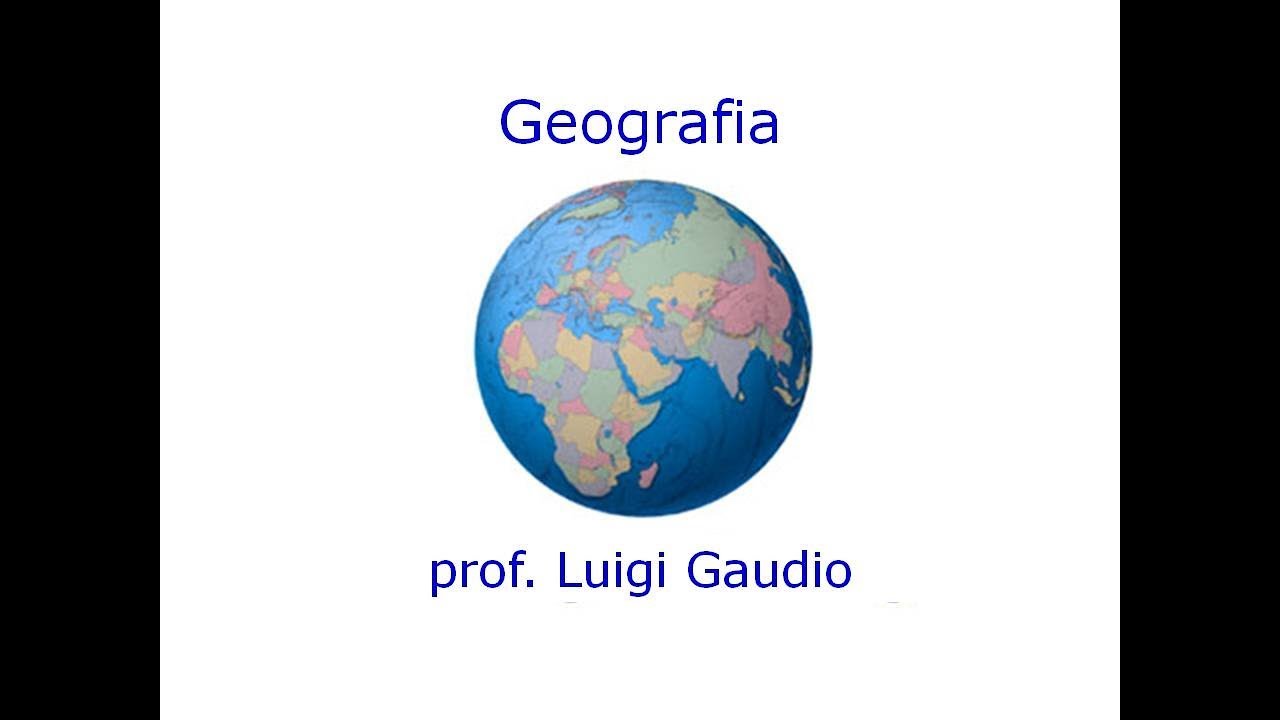
LES BANQUES
27 Gennaio 2019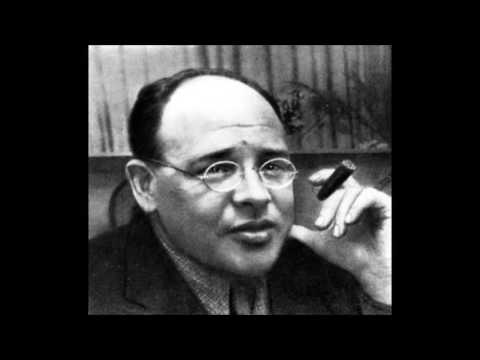
Isaac Emmanuilovi? Babel
27 Gennaio 2019Analyse de l’Étranger de Albert Camus
Résumé
Meursault va enterrer sa mère : il regarde, il écoute, il fume, passivement. Il ne participe pas ; il répond ; et c’est tout. Le lendemain, il rencontre Marie, se baigne avec elle, couche avec elle, sans rien vouloir, simplement parce qu’elle est là, et qu’il répond à ce qui l’interroge ou se présente. De même pour Raymond, son voisin, qui lui demande son amitié, et qu’il aide, comme on répond à qui vous parle avec insistance, sans rien penser de particulier. Et la vie coule, poussant les jours, le travail, le soleil, la mer, toutes choses que Meursault constate avec une conscience vide et lucide, toutes choses qui se reflètent sur lui mais auxquelles il ne se donne pas.
Raymond l’invite à pique-niquer avec Marie et un couple ami sur une plage. Tandis que les trois hommes se promènent, ils sont accostés par des Arabes qui ont un compte à régler avec Raymond. Bagarre. Meursault regarde. Plus tard, retourné seul vers la source qui coule à une extrémité de la plage, Meursault y rencontre l’un des Arabes. Cet homme ne lui est rien, et il n’a pas de haine, à peine le souvenir de ce qui s’est passé. Mais l’Arabe sort un couteau, la lame brille au soleil, et Meursault, qui par hasard a encore sur lui le revolver de Raymond, tire, tire encore, aveuglé par la lumière, la sueur, l’air brûlant…
Personnages
MEURSAULT
Meursault, le narrateur, relate les événements comme s’il était extérieur à lui-même, sans les commenter ou les situer dans une chaîne logique. Ainsi, il donne l’impression d’être parfaitement étranger au monde dans lequel il vit. Il y a donc deux points de vues différents dans la narration :
un point de vue interne (celui de Meursault, qui relate à la première personne son histoire)
un point de vue externe (Meursault parle de ce quilui arrive comme s’il s’agissait de quelqu’un d’autre)
Si Meursault est condamné, c’est d’abord pour s’être montré insensible au moment de l’enterrement de sa mère. Insensible, c’est-à-dire irrespectueux des convenances. Il n’a pas adopté le comportement qu’on attendait de lui en de telles circonstances. Il a fumé, bu du café au lait, refusé de voir le corps de sa mère ; il est allé au cinéma et a passé la nuit avec Marie Cardona… Tout se retourne contre lui au moment du procès et le procureur demande sa tête parce qu’il n’a pas montré les signes de douleur et ne s’est justifié ni au cours de l’instruction, ni pendant les audiences. On peut donc dire que le crime jugé dans l’Etranger n’est pas le meurtre de l’Arabe mais le mépris des conventions sociales.
C’est ainsi que Camus analyse après coup le comportement de son personnage dans la préface d’une édition de 1958 : “Dans notre société tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’etre condamné à mort (?). Le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens il est étranger à la société où il vit, il erre, en marge, dans les faubourgs de la vie privée, solitaire, sensuelle (?) il refise de mentir. Mentir ce n’est pas seulment dire ce qui n’est pas. C’est aussi, c’est surtout dire plus que ce qui est et, en ce qui concerne le coeur humain, dire plus qu’on ne sent (?) ; il refuse de masquer ses sentiments et aussitôt la société se sent menacée.” Meursault du reste n’a joué ni au fils éploré ni à l’assassin repentant.
Meursault, le personnage romanesque, vit à Belcourt, un faubourg populaire d’Alger. Il a des habitudes de célibataire (“Je me suis fait cuire des æufs et je les ai mangés à même le plat, sans pain parceque je n’en avais plus et que je ne voulais pas descendre en acheter.”), et les premières pages du romans le décrivent comme un employé dérangé dans sa routine par la mort de sa mère, qui va bouleverser son rytme quotidien. A chaque jour, les mêmes occupations, le bureau, le déjeuner chez Céleste, le “tram”, les bains de mer, les promenades sur le port, la contemplation des passants… C’est cette routine que le meurtre vient interrompre.
Si Meursalut n’exprime aucun sentiment, il éprouve des sensations fortes. Juste avant le meurtre, il ressent la brûlure du soleil de manière particulièrement aigüe. C’est ce mélange de sensations exacerbées sous l’action du soleil qui joue un rôle déterminant dans l’enchaînement qui le conduit à tuer.
Meursault n’est pas le même au début et à la fin du roman. Dans les premières pages, il évoque la mort de sa mère en langage administratif (“Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.”). A la fin du roman, Meursault pense à sa mère en d’autres termes (“Il m’a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle avait pris un “fiancé”, pourquoi elle avait joué à recommencer.”). Avant son exécution, il ne se contente plus de raconter les faits matériels qui occupent sa vie routinière. Ses sentiments à l’égard de sa mère ont évolué. Elle ne lui apparait plus comme une présence lointaine et indifférente. Il l’évoque comme un être humain, semblable à lui dans leur condition commune. Tout se passe comme si la proximité de la mort permettait à Meursault de trouver une relation nouvelle avec les autres et le reste du monde. Les différentes étapes de sa transformation correspondent à sa découverte de l’Absurde.
MARIE
Meursault retrouve cette dactylo qui a travaillé dans son bureau par hasard à l’établissement de bains du port. Avec elle il parle peu et il a essentiellement des rapports sensuels. Il se baigne avec elle à trois reprises et, à chaque fois, la présence physique de la jeune femme est associée à la perception d’une harmonie avec les éléments naturels : La mer et le soleil. Marie permet, en quelque sorte, la communion du héros avec la nature. Au cours des trois bains, Marie est liée à la présence de la mer, et son corps devient un élément du décors naturel parmi d’autres.
RAYMOND SINTES
Meursault devient son ami sans l’avoir choisi. C’est son voisin qui l’invite chez lui “à manger un morceau”. “J’ai pensé que cela m’éviterait de faire ma cuisine et j’ai accepté.” Il reste passif, comme avec Marie. Pourquoi Raymond Sintès lui demande-t-il d’écrire une lettre à sa maîtresse ? Ses motifs restent obscurs au lecteur et à Meursault, qui ne se pose pas la question. Meursault ne pose pas de jugement sur Raymond tout en connaissant sa réputation de souteneur.
Raymond joue un rôle important dans la condamnation de Meursault : à cause de la lettre qui permet au procureur de parler de la moralité douteuse de Meursault. C’est aussi Raymond qui a mis en contact la victime et le meurtrier, et a donné son revolver à Meursault.
SALAMANO
Ce personnage ne joue aucun rôle dans la progression de l’action. A la fin du chapitre 4, Salamano vient de perdre son chien et Meursault l’entend pleurer. D’autre part, c’est Salamano qui lui avait appris ce qu’on disait dans le quartier quand il avait mis sa mère à l’asile. La narration établi ainsi un rapport entre les deux couples : Meurault-sa mère et Salamano-son chien. Ces effets de miroir soulignent l’idée de la perte d’un être cher sans que de tels sentiments soient directement attribués à Meursault. Le lecteur est conduit par le jeu du texte à faire ses rapprochements et à interpréter Salamano comme un double déformé de Meursault.
LE STYLE
Le style de L’Etranger frappe tout d’abord par sa simplicité et son naturel. On ne trouve pas, derrière l’écriture de Camus, les habitudes rhétoriques, les volontés d’expression propres aux grands romanciers du XIX siècle et souvent charactéristiques d’une idéologie bourgeoise. Camus ne fait souvent que traduire fidèlement une façon de parler typique des français d’Algérie, elle-même héritée du style et du rythme du récit des Arabes : transcription simple des faits, appréciés en eux-mêmes, sans qu’il soit besoin de les organiser et surtout de les coordonner dans un discours cohérent, et qui finissent, en s’accumulant, par prendre une dimension épique.
En évoquant par de petites phrases courtes, que ne relie le plus souvent aucun rapport de cause ou de conséquences, les faits apparemment les plus anodins et les plus importants, Meursault paraît dénoncer comme de simples préjugés les points de vue différents que nous en avons d’habitude.
Son style exprime que pour lui, il n’existe pas de petits problèmes ; son observation des détails (les vis du cercueil) ou sa manière de peser en toutes choses le pour et le contre (“dans un sens… dans un autre…”) révèlent un esprit scrupuleux et observateur.
A travers Meursault, personnage indifférent aux valeurs traditionnelles, Camus nous fait redécouvrir un monde que l’on croyait familier.
DUREE DE L’ACTION
La première partie du récit couvre dix-huit jours, entre le jeudi où Meursault reçoit le télégramme et le dimanche du drame. Nous sommes au début du roman au mois de juin (la saison de football, qui ne dépassait jamais le 30 juin en Algérie, n’est pas terminée). Sans doute sommes-nous en juillet le jour du meurtre.
La deuxième partie couvre près d’un an : l’instruction a duré onze mois, auxquels il faut ajouter le temps du procès et les jours que Meursault passe dans sa cellule après le verdict. Le proçès lui-même se déroule en juin.
Bien qu’il s’étale sur un an, le récit se situe presque entièrement en été, et plus précisément en juin-juillet.
Le temps du roman est linéaire, c’est-à-dire qu’il ne comporte pas de retour en arrière à l’intérieur du récit de Meursault. Chaque chapitre nous fait progresser dans le temps, à l’exception des chapitres 1 et 2 de la deuxième partie, qui relatent les événements d’une même période, mais de caractère différent.
LA SOCIETE
L’indifférence de Meursault devant les autres va se trouver modifiée après le crime. En le prenant à partie, la société va l’obliger à réagir. Paradoxalement elle éveille en lui des sentiments de sympathie qu’il n’éprouvait pas auparavant. Le juge lui apparaît “très raisonable et, somme toute, sympathique” ; le mécontentement de son avocat le désole :”Il est parti avec un air fâché. J’aurais voulu le retenir, lui expliquer que je désirais sa sympathie, non pour être mieux défendu, mais, si je puis dire, naturellement”.
L’évolution de Meursault se fait sentir dans la façon dont nous apparaissent les représentants de la société. Il décrit tout d’abord les petits détails qui le frappent (la cravate bizarre de l’avocat, la robe rouge du président). Cependant dès l’ouverture du procès, les yeux clairs du journaliste qui l’examine attentivement ne lui échappent pas. Meursault leur donne même un sens : “Et j’ai eu l’impression bizarre d’être regardé par moi-même.” Le procès tout entier va apparaître de moins en moins à Meursault comme un spectacle et il se sentira de plus en plus concerné par ce qui se passe. Il remarque “le regard triomphant de l’avocat général”, puis “la lueur ironique” qui brille dans ses yeux ; il trouve son avocat “ridicule”. Lorsqu’il décrit l’aumônier plus rien ne lui échappe : il remarque la douceur, la tristesse, l’agacement du personnage.
Lorsqu’il décrivait les autres personnages Meursault ne nous donnait qu’un point de départ, souvent insignifiant. L’idée qu’il nous donne de l’aumônier, au contraire, est très précise car il est maintenant plus sensible au rapport qu’il entretient avec les gens qu’à leur apparence brute.
EXTRAITS
Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : “Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.” Cela ne veut rien dire. C’était peut-être hier.
L’asile de vieillards est à Marengo, à quatre-vingts kilomètres d’ Alger. Je prendrai l’autobus à deux heures et j’arriverai dans l’après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J’ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n’avait pas l’air content. Je lui ai même dit : “Ce n’est pas de ma faute.” Il n’a pas répondu. J’ai pensé alors que je n’aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n’avais pas à m’excuser. C’était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c’est un peu comme si maman n’était pas morte. Après l’enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
J’ai pris l’autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J’ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m’a dit : “On n’a qu’une mère.” Quand je suis parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois.
J’ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots, à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J’ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé contre un militaire qui m’a souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit “oui” pour n’avoir plus à parler. L’asile est à deux kilomètres du village. J’ai fait le chemin à pied. J’ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m’a dit qu’il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j’ai attendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j’ai vu le directeur : il m’a reçu dans son bureau. C’était un petit vieux, avec la Légion d’honneur. Il m’a regardé de ses yeux clairs. Puis il m’a serré la main qu’il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. I1 a consulté un dossier et m’a dit : “Mme Meursault est entrée ici il y a trois ans. Vous étiez son seul soutien.” J’ai cru qu’il me reprochait quelque chose et j’ai commencé à lui expliquer. Mais il m’a interrompu : “Vous n’avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J’ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouviez subvenir à ses besoins. I1 lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici.” J’ai dit : “Oui, monsieur le Directeur.” Il a ajouté : “Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d’un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s’ennuyer avec vous.”
C’était vrai. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l’asile, elle pleurait souvent. Mais c’était à cause de l’habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l’avait retirée de l’asile. Toujours à cause de l’habitude. C’est un peu pour cela que dans la dernière année je n’y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche – sans compter l’effort pour aller à l’autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route.
Le directeur m’a encore parlé. Mais je ne l’écoutais presque plus. Puis il m’a dit : “Je suppose que vous voulez voir votre mère.” Je me suis levé sans rien dire et il m’a précédé vers la porte. Dans l’escalier, il m’a expliqué : “Nous l’avons transportée dans notre petite morgue. Pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu’un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant deux ou trois jours. Et ça rend le service difficile.” Nous avons traversé une cour où il y avait beaucoup de vieillards, bavardant par petits groupes. Ils se taisaient quand nous passions. Et derrière nous, les conversations reprenaient. On aurait dit d’un jacassement assourdi de perruches. A la porte d’un petit bâtiment, le directeur m’a quitté : “Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition dans mon bureau. En principe, l’enterrement est fixé à dix heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot : votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d’être enterrée religieusement. J’ai pris sur moi de faire le nécessaire. Mais je voulais vous en informer.” Je l’ai remercié. Maman, sans être athée, n’avait jamais pensé de son vivant à la religion.
Je suis entré. C’était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d’une verrière. Elles était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d’entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête.
A ce moment, le concierge est entré derrière mon dos. Il avait dû courir. Il a bégayé un peu : “On l’a couverte, mais je dois dévisser la bière pour que vous puissiez la voir.” Il s’approchait de la bière quand je l’ai arrêté. Il m’a dit : “Vous ne voulez pas ?” J’ai répondu : “Non.” Il s’est interrompu et j’étais gêné parce que je sentais que je n’aurais pas dû dire cela. Au bout d’un moment, il m’a regardé et il m’a demandé : “Pourquoi ?” mais sans reproche, comme s’il s’informait. J’ai dit : “Je ne sais pas.” Alors tortillant sa moustache blanche, il a déclaré sans me regarder : “Je comprends.” Il avait de beaux yeux, bleu clair, et un teint un peu rouge. Il m’a donné une chaise et lui-même s’est assis un peu en arrière de moi. La garde s’est levée et s’est dirigée vers la sortie. A ce moment, le concierge m’a dit : “C’est un chancre qu’elle a.” Comme je ne comprenais pas, j’ai regardé l’infirmière et j’ai vu qu’elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de la tête. A la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage.
[…]
En me réveillant, j’ai compris pourquoi mon patron avait l’air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé : c’est aujourd’hui samedi. Je l’avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m’est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j’aurais ainsi quatre jours de vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d’une part, ce n’est pas ma faute si on a enterré maman hier au lieu d’aujourd’hui et d’autre part, j’aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu, cela ne m’empêche pas de comprendre tout de même mon patron.
J’ai eu de la peine à me lever parce que j’étais fatigué de ma journée d’hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j’allais faire et j’ai décidé d’aller me baigner. J’ai pris le tram pour aller à l’établissement de bains du port. Là, j’ai plongé dans la passe. Il y avait beaucoup de jeunes gens. J’ai retrouvé dans l’eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j’avais eu envie à l’époque. Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n’avons pas eu le temps. Je l’ai aidée à monter sur une bouée et, dans ce mouvement, j’ai effleuré ses seins. J’étais encore dans l’eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s’est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d’elle sur la bouée. Il faisait bon et comme en plaisantant, j’ai laissé aller ma tête en arrière et je l’ai posée sur son ventre. Elle n’a rien dit et je suis resté ainsi. J’avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. Sous ma nuque, je sentai le ventre de Marie battre doucement. Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu trop fort, elle a plongé et je l’ai suivie. Je l’ai rattrapée, j’ai passé ma main autour de sa taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Sur le quai, pendant que nous nous séchions, elle m’a dit : “Je suis plus brune que vous.” Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma le soir. Elle a encore ri et m’a dit qu’elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l’air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m’a demandé si j’étais en deuil. Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j’ai répondu : “Depuis hier.” Elle a eu un petit recul, mais n’a fait aucune remarque. J’ai eu envie de lui dire que ce n’était pas ma faute, mais je me suis arrêté parce que j’ai pensé que je l’avais déjà dit à mon patron. Cela ne signifiait rien. De toute façon, on est toujours un peu fautif.
Le soir, Marie avait tout oublié. Le film était drôle par moments et puis vraiment trop bête. Elle avait sa jambe contre la mienne. Je lui caressais les seins. Vers la fin de la séance, je l’ai embrassée, mais mal. En sortant elle est venue chez moi.
Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m’avait expliqué qu’elle devait aller chez sa tante. J’ai pensé que c’était dimanche et cela m’a ennuyé : je n’aime pas le dimanche. Alors, je me suis retourné dans mon lit, j’ai cherché dans le traversin l’odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissée et j’ai dormi jusqu’à dix heures. J’ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché jusqu’à midi. Je ne voulais pas déjeuner chez Céleste comme d’habitude parce que, certainement, ils m’auraient posé des questions et je n’aime pas cela. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même le plat sans pain parce que je n’en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter.
Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j’ai erré dans l’appartement. Il était commode quand maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j’ai dû transporter dans ma chambre la table de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées, l’armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l’abandon. Un peu plus tard, pour faire quelque chose, j’ai pris un vieux journal et je l’ai lu. J’y ai découpé une réclame des sels Kruschen et je l’ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m’amusent dans les journaux. Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.
Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L’après-midi était beau. Cependant, le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C’étaient d’abord des familles allant en promenade, deux petits garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. Et le voyant avec sa femme, j’ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu’il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouges, le veston très cintré, avec une pochette brodée et des souliers à bouts carrés. J’ai pensé qu’ils allaient aux cinémas du centre. C’était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort.
Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n’y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d’en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l’a installée devant sa porte et l’a enfourchée en s’appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à l’heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café “Chez Pierrot”, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C’était vraiment dimanche.
[…]
Aujourd’hui j’ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. Il m’a demandé si je n’étais pas trop fatigué et il a voulu savoir aussi l’âge de maman. J’ai dit “une soixantaine d’années”, pour ne pas me tromper et je ne sais pas pourquoi il a eu l’air d’être soulagé et de considérer que c’était une affaire terminée.
Il y avait un tas de connaissements qui s’amoncelaient sur ma table et il a fallu que je les dépouille tous. Avant de quitter le bureau pour aller déjeuner, je me suis lavé les mains. A midi, j’aime bien ce moment. Le soir, j’y trouve moins de plaisir parce que la serviette roulante qu’on utilise est tout à fait humide : elle a servi toute la journée. J’en ai fait la remarque un jour à mon patron. Il m’a répondu qu’il trouvait cela regrettable, mais que c’était tout de même un détail sans importance. Je suis sorti un peu tard, à midi et demi, avec Emmanuel, qui travaille à l’expédition. Le bureau donne sur la mer et nous avons perdu un moment à regarder les cargos dans le port brûlant de soleil. A ce moment, un camion est arrivé dans un fracas de chaînes et d’explosions. Emmanuel m’a demandé “si on y allait” et je me suis mis à courir. Le camion nous a dépassés et nous nous sommes lancés à sa poursuite. J’étais noyé dans le bruit et la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que cet élan désordonné de la course, au milieu des treuils et des machines, des mâts qui dansaient sur l’horizon et des coques que nous longions. J’ai pris appui le premier et j’ai sauté au vol. Puis j’ai aidé Emmanuel à s’asseoir. Nous étions hors de souffle, le camion sautait sur les pavés inégaux du quai, au milieu de la poussière et du soleil. Emmanuel riait à perdre haleine.
Nous sommes arrivés en nage chez Céleste. Il était toujours là, avec son gros ventre, son tablier et ses moustaches blanches. Il m’a demandé si “ça allait quand même”. Je lui ai dit que oui et que j’avais faim. J’ai mangé très vite et j’ai pris du café. Puis je suis rentré chez moi, j’ai dormi un peu parce que j’avais trop bu de vin et, en me réveillant, j’ai eu envie de fumer. Il était tard et j’ai couru pour attraper un tram. J’ai travaillé tout l’après-midi. Il faisait très chaud dans le bureau et le soir, en sortant, j’ai été heureux de revenir en marchant lentement le long des quais. Le ciel était vert, je me sentais content. Tout de même, je suis rentré directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies.
En montant, dans l’escalier noir, j’ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a huit ans qu’on les voit ensemble. L’épagneul a une maladie de peau, le rouge, je crois, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. A force de vivre avec lui, seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune et rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d’allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l’air de la même race et pourtant ils se détestent. Deux fois par jour, à onze heures et à six heures, le vieux mène son chien promener. Depuis huit ans, ils n’ont pas changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l’homme jusqu’à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien alors et il l’insulte. Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. A ce moment, c’est au vieux de le tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors, ils restent tous les deux sur le trottoir et ils se regardent, le chien avec terreur, l’homme avec haine. C’est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse pas le temps et il le tire, l’épagneul semant derrière lui une traînée de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans la chambre, alors il est encore battu. Il y a huit ans que cela dure. Céleste dit toujours que “c’est malheureux”, mais au fond, personne ne peut savoir. Quand je l’ai rencontré dans l’escalier, Salamano était en train d’insulter son chien. Il lui disait : “Salaud ! Charogne !” et le chien gémissait. J’ai dit : “Bonsoir”, mais le vieux insultait toujours. Alors je lui ai demandé ce que le chien lui avait fait. Il ne m’a pas répondu. Il disait seulement : “Salaud ! Charogne !” Je le devinais, penché sur son chien, en train d’arranger quelque chose sur le collier J’ai parlé plus fort. Alors sans se retourner, il m’a répondu avec une sorte de rage rentrée : “Il est toujours là.” Puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses quatre pattes, et gémissait.
Juste à ce moment est entré mon deuxième voisin de palier. Dans le quartier, on dit qu’il vit des femmes. Quand on lui demande son métier, pourtant, il est “magasinier”. En général, il n’est guère aimé. Mais il me parle souvent et quelquefois il passe un moment chez moi parce que je l’écoute. Je trouve que ce qu’il dit est intéressant. D’ailleurs, je n’ai aucune raison de ne pas lui parler. Il s’appelle Raymond Sintès. Il est assez petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Lui aussi m’a dit, en parlant de Salamano : “Si c’est pas malheureux !” Il m’a demandé si ça ne me dégoûtait pas et j’ai répondu que non.
Nous sommes montés et j’allais le quitter quand il m’a dit : “J’ai chez moi du boudin et du vin. Si vous voulez manger un morceau avec moi…” J’ai pensé que cela m’éviterait de faire ma cuisine et j’ai accepté. Lui aussi n’a qu’une chambre, avec une cuisine sans fenêtre. Au-dessus de son lit, il a un ange en stuc blanc et rose, des photos de champions et deux ou trois clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il a d’abord allumé sa lampe à pétrole, puis il a sorti un pansement assez douteux de sa poche et a enveloppé sa main droite. Je lui ai demandé ce qu’il avait. Il m’a dit qu’il avait eu une bagarre avec un type qui lui cherchait des histoires.
“Mais mon avocat, à bout de patience, s’est écrié en levant les bras, de sorte que ses manches en retombant ont découvert les plis d’une chemise amidonnée : “Enfin, est-il accusé d’avoir enterré sa mère ou d’avoir tué un homme ? ” Le public a ri. Mais le procureur s’est redressé encore, s’est drapé dans sa robe et a déclaré qu’il fallait avoir l’ingénuité de l’honorable défenseur pour ne pas sentir qu’il y avait entre ces deux ordres de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. “Oui, s’est-il écrié avec force, j’accuse cet homme d’avoir enterré une mère avec un cœur de criminel.” Cette déclaration a paru faire un effet considérable sur le public. Mon avocat a haussé les épaules et essuyé la sueur qui couvrait son front. Mais lui-même paraissait ébranlé et j’ai compris que les choses n’allaient pas bien pour moi.”
ANALYSE
Si près de la mort, vidé de tout espoir comme de toute crainte, Meursault s’ouvre “pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin j’ai senti que j’avais été heureux et que je l’étais encore”. Dans l’interprétation de ces quelques lignes tient la compréhension d’une œuvre pour laquelle le rapport à la mère et/ou à la nature (là est le nœud du problème et la durée initiatique d’une histoire) joue le rôle essentiel.
Si l’on tente de lire le dénouement de L’Étranger à la lumière théorique et rétrospective du Mythe de Sisyphe, plusieurs interprétations se présentent à nous qui toutes nous disent que Meursault n’a pas su “soutenir le pari déchirant et merveilleux de l’absurde”, car ces interprétations sont autant d’explications d’un “consentement”. Si par exemple Meursault consent à sa propre mort il peut être comparé au suicidé. C’est l’acceptation à la limite. “Tout est consommé, l’homme rentre dans son histoire essentielle. Son avenir, son seul et terrible avenir, il le discerne et s’y précipite”. Le suicide résout donc l’absurde. Il l’entraîne dans la mort. Certes Meursault n’a pas les moyens de sa propre mort, mais dans ce cas de figure il veut, à la manière héroïque et humoristique du sage stoïcien, ce qui lui arrive : sa condamnation à avoir la tête tranchée… Et par là même il échappe à l’absurde.
Deuxième hypothèse : Il s’agissait de “mourir irréconcilié” et c’est en communion avec le monde que Meursault va au contraire à la mort. Sa réconciliation finale n’apparaît alors que comme une ultime illusion consolatrice. En revêtant le monde d’un sens illusoire, Meursault cède à cette exigence anthropomorphique de familiarité avec ce qui pourtant nous est radicalement hostile et étranger. Il a nié “l’épaisseur” et “l’étrangeté” du monde et par là même l’absurde s’est évanoui. “Il y a tant d’espoir tenace dans le cœur humain. Les hommes les plus dépouillés finissent quelquefois par consentir à l’illusion. Cette approbation dictée par le besoin de paix est le frère intérieur du consentement existentiel”.
Autre hypothèse : Meursault aurait adopté une philosophie de type chestovien, il consentirait non plus à la mort ni à la nature mais à l’absurde lui-même ; et éprouverait, dans sa communion avec le monde, “la griserie de l’irrationnel et la vocation à l’extase” qui détourne nécessairement de l’absurde un esprit clairvoyant. Ainsi la révolte est-elle à nouveau éludée : “L’homme intègre l’absurde et dans cette communion fait disparaître son caractère essentiel qui est opposition, déchirement et divorce. Ce saut est une dérobade”. Car l’irrationnel est ici devenu dieu. Et sans doute Camus ne choisit pas et n’adhère lui-même à aucune de ces réponses. Avec celle du héros absurde accompli, il propose sans référence à L’ Étranger, ces possibilités en vrac à la méditation du lecteur, écrivant par ailleurs qu’ “une œuvre absurde (…) ne fournit pas de réponses”.
La leçon philosophique finale de L’ Étranger dit qu’entre le monde et l’homme, comme entre la mère et l’enfant, il n’y a pas séparation mais unité ontologique.
La figure du Christ hante L’ Étranger, et Camus multiplie son sens. Le Nietzsche de L’Antéchrist nourrit ici le texte de ses significations. Antéchrist, c’est la dénomination que reprend ironiquement – et symptomatiquement – à l’adresse de Meursault, le juge d’instruction à la fin de chacun de ses interrogatoires : “C’est fini pour aujourd’hui, monsieur l’Antéchrist”. Cette appellation n’a pas, bien sûr, le même sens pour le juge et pour l’auteur. Pour le juge, anté signifie anti et l’expression joanique de L’Apocalypse, dit l’indifférence et l’insensibilité de Meursault (l’endurcissement du cœur) face à l’image paradigmatique de la douleur rédemptrice qu’exprime le crucifix que le juge brandit avec véhémence devant les yeux du pécheur : “Moi je suis chrétien. Je demande pardon de tes fautes à celui-là. Comment peux-tu ne pas croire qu’il a souffert pour toi ? Face à la harangue du théologien-juge, sur le sacrifice de l’innocent pour les fautes du coupable, Camus – suivant en ce sens Nietzsche – décrit à travers Meursault un christ ou un Antéchrist d’un tout autre type : un christ d’avant la théologie chrétienne, d’avant l’invention de la faute, du péché, du sacrifice et du rachat, un christ essentiellement innocent, en communion immédiate avec Dieu dans une expérience vécue d’une béatitude qui n’est pas le privilège d’un seul ou de quelques-uns mais qui peut-être partagé par tous, “en tant que vie dans l’amour sans réticence ni exclusive, sans distance” ni résistance. Meursault, à l’exemple de sa mère, à l’exemple de ce christ (qu’elle est aussi) et que Nietzsche décrit, Meursault non plus “ne résiste pas, il ne défend pas son droit, il ne fait pas un geste pour détourner de lui l’extrême, bien mieux, il le provoque…” Et cette négation n’est pas un abandon, c’est un choix. Dans un schéma historique essentiellement nietzschéen, Meursault exprimerait donc (dans l’identité à sa mère) le type du “dernier homme”, celui pour qui “tout est vide, tout est égal, tout est révolu”. C’est le stade du nihilisme passif, c’est-à-dire le “point zéro” d’épuisement d’une culture (ou d’une imagination) qui retrouverait ainsi, dans sa fin, le type naturel, élémentaire de son origine mais aussi le point d’appui d’un possible rebondissement. Le dernier homme prépare une renaissance.
Dans le parloir bruyant et grillagé de la prison où les êtres compensent par des cris la distance de la séparation, dans cet espace limité où les fragments de phrases simplifiées à l’extrême se choquent les uns contre les autres de manière absurde, où Marie avec un sourire crispé tente artificiellement de faire vivre l’espoir – c’est notre monde même… – Meursault remarque à coté de lui un “petit jeune homme aux mains fines” en face d’une “petite vieille” qui se regardent sans parler avec intensité :” Le seul îlot de silence était à côté de moi dans ce petit jeune homme cette vieille qui se regardaient. Peu à peu, on a emmené les Arabes. Presque tout le monde s’est tu dès que le premier est sorti. La petite vieille s’est rapprochée des barreaux et, au même moment, un gardien a fait signe à son fils. Il a dit : “Au revoir, maman” et elle a passé sa main entre deux barreaux pour lui faire un petit signe lent et prolongé”. Communion intense et silencieuse et, finalement, inéluctable séparation de la mère et de l’enfant, de l’homme et du monde. Ce petit signe entre les barreaux, sans espoir, c’est aussi celui qu’à l’orée de la mort et au cœur même de sa fraternité avec le monde, Meursault perçoit au sein de la “nuit chargée de signes et d’étoiles”. Signe d’adieu de la vie, adieu de la mère à son fils du fond de la nuit de sa vérité. Comme l’enseigne Épicure, la séparation et la mort sont nécessairement incluses dans les pactes de l’homme avec la nature. La mère transmet silencieusement la vie et se retire lentement, laissant son fils dans la prison du monde. Dans le monde absurde la valeur d’une vie se mesure à son infécondité et la mère de Jacques et de Meursault “a choisi d’être rien”. Et cette stérilité, qui échappe au mensonge, est exemplaire : elle libère l’amour de l’imagination, du désir d’identification et de possession et de la suite de toutes ses affections passives. Elle signifie aussi cependant un accroissement de la disponibilité à la vie dans sa diversité. L’amour exclusif de la mère totalisatrice, dévorante et névrotique, fait place à une tendre indifférence, un certain “air d’absence et de douce distraction comme en porte perpétuellement certains innocents” et dont seule l’immense solitude d’une terre magnifique et sans âme, sereine et primitive, peut donner la mesure. Silencieusement, discrètement, la mère s’est faite nature s’accordant “à cet immense pays autour de lui dont, tout enfant, il avait senti la pesée avec l’immense mer devant lui, et derrière lui cet espace interminable de montagnes, de plateaux et de désert qu’on appelait l’intérieur, et entre les deux le danger permanent dont personne ne parlait parce qu’il paraissait naturel…” Et Meursault de s’ouvrir librement à ce vide immense, à cette présence permanente de la mort et, en même temps aussi, à la richesse du monde. Son chemin : de n”être rien à être plusieurs”.
Il y a le contentement parfait dans les choses les plus simples : “Le ciel était vert, je me sentais content. Tout de même, je suis rentré directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies” ; la vie retirée dans une seule pièce… “le reste est à l’abandon” ; l’aptitude que Meursault se reconnaît de pouvoir “vivre dans un tronc d’arbre sec sans autre occupation que de regarder la fleur du ciel”. Là s’exprime sans doute l’activité immobile caractéristique de l’energeia épicurienne. L’exploration du divers paraît alors, du point de vue de cette simplification de la vie, contradictoire. C’est pourtant le contraire d’une agitation suscitée par le manque et l’infinité illusoire des désirs. Plutôt l’extension indéfinie de l’activité immobile d’une plénitude. Meursault c’est aussi Don Juan. Cette vie le comble. Il ne connaît pas le manque, mais son désir court pourtant de corps en corps. Il se promène avec Marie et attire son attention sur la beauté des femmes. Ils vont à la plage :” j’ai remarqué tout de suite une fille magnifique en maillot blanc, et j’en ai eu envie”…
Revenons à la pauvreté. Celle qui a ramené Meursault auprès de sa mère après quelque temps passé à Paris pour des études supérieures qu’il n’a pas pu terminer et dont on ne saura rien ; pauvreté qui a supprimé en lui, avec ses ambitions, tout espoir et tout regret, et qui l’amène à présent à penser en vérité qu’au fond on ne change jamais de vie, que toutes se valent et que la sienne, disponible au hasard d’un “ciel plein de rougeur” ou d’ “une odeur de sel”, ne lui déplaît pas du tout. Cette pauvreté qui le conduit enfin à mettre sa mère à l’asile au moment même où leur mutuel silence, épuisé de sa richesse initiatique, est devenu celui de l’ennui, de la séparation inéluctable des êtres et déjà de la mort : “maman ni moi n’attendions plus rien l’un de l’autre, ni d’ailleurs de personne”. C’est pourtant par fidélité à la vérité de la mère, par fidélité essentielle à la vie, que Meursault s’en sépare ou plutôt entérine, par son acte, le divorce que l’existence avait déjà ouvert irréversiblement entre eux. Par un même geste, il libère sa mère de sa propre présence comme objet hallucinatoire et exclusif du désir, et la rend disponible à d’autres amours : “Quand elle était à la maison maman passait son temps à me suivre des yeux en silence”. A l’asile elle trouvera un “fiancé” et jouera à tout recommencer. Ce que le frère de Catherine Cormery avait, sous les yeux du jeune Jacques, empêché, Meursault le rend possible pour sa propre mère. Il faut voir là de la gratitude, le don d’une seconde naissance. Le rapport mère-enfant est réversible car il n’y a en réalité que des fraternités par lesquelles la vie se diffuse, rebondit, ressuscite, se multiplie, s’amplifie.
La mère disparue ne sera plus alors évoquée qu’en rapport avec cet amour fraternel de la vie, de la nature et du plaisir devant la beauté de la terre. Le parcours de Meursault va ainsi de l’expérience du vide, de son aptitude à désaffecter l’univers des mythes et des sentiments qui y sont assujettis, à celle de la densité et de la diversité réelle du réel, en lui-même et en dehors de soi.
“Je n’ai jamais eu, confie Meursault, de véritable imagination”. A ce quasi degré zéro du fanatisme ou de l’hallucination, ce sont les structures en apparence les plus naturelles de notre rapport au monde et à autrui qui sont bouleversées. Car l’unité, l’identité à partir desquelles nous reconnaissons un autre homme voire une chose, font elles-mêmes aussi déjà partie de l’imagination. Lorsque Meursault, par fidélité à la richesse du réel, à sa vérité, refuse de simplifier la vie – c’est-à-dire de mentir sur la réalité de ses sentiments en identifiant ceux-ci en fonction du consensus sur ce qui doit être fait ou ressenti voire même du consensus sur des mots (c’est de la peine, c’est du regret, c’est de l’amour…) – par ce refus, il affirme que la vie tout entière, que chaque vie est vouée à la vérité de sa dispersion, de sa multiplicité, de sa diversité. Et que cette réalité est irréductible aux signes, à l’identique ou au contradictoire, qu’elle est silencieuse, affective, relationnelle, multiple. Mais aussi que cette vérité est autant la sienne que celle du monde. Par là Meursault se délivre du déchirement absurde. Cette richesse du monde c’est lui-même, rien ne l’en sépare, rien en lui ne s’y oppose. Son silence – celui de la vie comme celui de la mort – c’est son propre silence. Cet amour désintéressé, cette tendre indifférence qu’il ressent en toutes choses, c’est son propre amour de la vie libre de toute possession, de toute identification, de tout “objet”… Cet immanentisme radical parcourt, à travers le jeu de ses symboles, le chemin initiatique de Meursault : la mère disparue, mise en terre la veille, Marie apparaît.
Marie. C’est la mère emblématique, celle du Christ. Pour Meursault c’est la femme-mère, la médiation entre l’union avec sa propre mère et son accord avec la nature. Marie ne se distingue pas d’ailleurs réellement de la nature ni des attributs maternels. Meursault la rencontre “dans l’eau” (celle de la naissance et du baptême) , effleure immédiatement ses seins, s’endort comme un enfant sur son ventre. Marie sommeille avec lui. Ils ne parlent pas. Le soir “elle est venue chez moi”. Que dire de Marie sinon qu’elle est tout en surface, celle de la beauté de son corps brun. Marie c’est la nature en mouvement dans son affirmation singulière, comme corps, comme pure joie, comme plénitude : elle rit sans cesse. L’inverse en apparence de l’immobilité et du vide de la mère. Mais c’est pourtant la même prégnance du présent, le même savoir de la vie, la même liberté. Son rire c’est son silence. Sa sagesse même. Marie ne dit rien d’autre que l’urgence du plaisir de vivre. Elle libère la sagesse de la figure encore réactive de la résignation. Et c’est avec ce désir, ces rires, ces fragments de corps et de tissu, ces mouvements fugitifs du visage, que Meursault s’unit avec Marie/la mère/la nature, en deçà du moi (le sien ou celui de Marie) dans l’immanence des purs affects.
Cette union atteint son point sublime durant la matinée du dimanche. Le texte a ici, plus qu’ailleurs encore, la simplicité d’un système. Union tout d’abord avec les quatre éléments : l’eau (“l’eau était froide et j’étais content de nager”), l’air (“je suis entré en nageant régulièrement et en respirant bien”), la terre (“j’ai mis ma figure dans le sable. Je lui ai dit que c’était bon…”), le feu (“j’étais occupé à éprouver que le soleil me faisait du bien”). Puis union avec Marie ; dans l’eau tout d’abord, selon un même corps (“avec Marie, nous nous sommes éloignés et nous nous sentions d’accord dans nos gestes et dans notre consentement. (…) Marie a voulu que nous nagions ensemble. Je me suis mis derrière elle pour la prendre par la taille et elle avançait à la force des bras pendant que je l’aidais en battant des pieds”) ; et sur le sable (“elle s’est allongée flanc à flanc avec moi et les deux chaleurs de son corps et du soleil m’ont un peu endormi”). Marie lui fera remarquer qu’il ne l’a pas embrassée depuis le matin. Là où Meursault vit la béatitude de la symbiose, les signes d’amour, le désir même de s’unir à l’autre davantage (dans un baiser par exemple) n’ont plus de place. Les structures du moi et d’autrui se sont dissoutes. Marie n’est plus “objet de désir”. Dans cette jouissance illimitée de l’être il n’y a plus rien à dire, à montrer, à prouver ou à désirer. Cette plénitude se vit dans une douce somnolence. C’est le sommeil comblé du nourrisson “sommeil léger et sans rêves”. Ce contact direct au monde est un moment d’innocence… qui pareillement peut se renverser en cruauté. Le moment du crime sera aussi celui d’un contact direct avec les éléments, aussi innocent. Pour le meilleur ou le pire, le plus grand plaisir ou l’extrême douleur, démuni de la cuirasse de nos illusions, Meursault vit totalement exposé à la tendresse ou à la fureur du réel. Cette passivité est déjà aussi sa force.
Meursault est avec Marie ou la nature, comme l’enfant avec sa mère, totalement disponible à sa chaleur, son amour, mais par lui-même passif. De la mère-nature lui vient tout son contentement. C’est par elle qu’il entre en accord avec elle, comme avec lui-même. Entre l’union de la plage et celle de la prison il y a ainsi à la fois continuité et rupture. Continuité dans l’innocence et la jouissance du rapport au monde et à soi-même. Rupture dans le passage de l’affect joyeux passif à l’affect actif de la béatitude. Par la connaissance, l’innocent devient autonomie. Certes la joie passive de Meursault suppose elle-même l’activité d’une affirmation qui est celle de la sagesse spontanée du corps au présent quand il est libre de tout avenir. Car en lui-même “le corps ignore l’espoir”.Mais cette activité anonyme et sans fin de notre persévérance est livrée aux circonstances extérieures qui font et défont à leur gré notre accord aux autres, au monde et à nous-même. Dans la prison, c’est du point de vue de sa propre force, de sa propre lucidité, que Meursault éprouve son accordessentielaveclui-mêmecommeavecle monde. La sagesse spontanée du corps est devenue celle d’une connaissance adéquate. Toute la joie silencieuse et sereine de Meursault est là, son bonheur lui appartient et il est irréversible. Dans un amour si puissant et lucide de la vie qu’il le rend aussi capable de dire “oui” à la mort sans que ce “oui” ne soit en aucun cas l’expression d’un désir de mourir, mais au contraire le consentement au monde le plus heureux, le plus tendre et le plus humain.
Le rapport de Meursault à Marie est donc vrai et totalement physique : c’est une union des corps. Et pourtant radicalement différente voire opposée de ce qu’habituellement on entend par là. Car Marie n’est pas pour Meursault “un” corps identifié à une chose, un objet qu’on s’approprie et dont on jouit, ni d’ailleurs inversement un sujet, une “personne” – autre face morale de la même pièce imaginative. Misère de tous les mensonges du dualisme et de la “moraline”. Marie c’est un désir. Le contraire d’ “un sentiment pour son coït” suivant l’image que Raymond donne du rapport qu’il entretient avec sa maîtresse. Ce sont l’imagination et les fantasmes qui réduisent la femme à une identité, un corps, une chose, “la” chose (le coït) ou inversement (mais c’est la même chose) la personne morale par excellence, la Mère. C’est selon une même logique que Raymond veut entraîner Meursault au bordel :”j’ai dit non parce que je n’aime pas ça”. Le refus est éclairant. Meursault ne fait pas l’amour avec des images.
Meursault désire spontanément contenter Raymond, sans penser aux possibles conséquences de ses actes, malgré la très mauvaise réputation de son voisin. Il regrette aussi devoir mécontenter son patron. Mais sa sympathie avec Alger qu’il aime, la mer et le soleil, et inversement son antipathie pour Paris (“C’est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les gens ont la peau blanche”) sont trop fortes pour lui permettre d’accepter ce changement de vie. Sympathie ou antipathie correspondent ainsi aux aptitudes à affecter ou à être affecté des corps. “Le ciel était vert, je me sentais content” : c’est de la sympathie. Par contre Meursault remarque les avant-bras “très blancs sous les poils noirs” de Raymond :”j’en étais un peu dégoûté”, dit-il.
Loin d’être étranger aux autres et au monde, le désir spontané de Meursault est pourtant dans une sympathie immédiate, naturelle, avec tout ce qui l’entoure. Et cela en dehors de souci de soi. De son avocat, qui part d’un air fâché, il nous dit qu’il aurait voulu le retenir, “lui expliquer que je désirais sa sympathie, non pour être mieux défendu, mais, si je puis dire, naturellement”. Un journaliste qui s’adresse à lui et qu’il trouve “sympathique”, lui dit que son affaire sera câblée vers Paris ; “j’ai failli le remercier. Mais j’ai pensé que ce serait ridicule”. Lorsqu’il se sent détesté il a, comme un enfant, naturellement l’envie de pleurer. Ce désir spontané du désir de l’autre n’est nullement encore le symptôme d’un manque ou d’une demande d’amour. A Raymond qui désire être son copain il répond “oui” et commente : “Cela m’était égal d’être son copain et il avait vraiment l’air d’en avoir envie”. Sa sympathie est déjà aussi de la générosité. Elle le conduira en prison. Après l’incident avec les Arabes, Raymond veut retourner sur la plage. Masson et Meursault veulent l’accompagner. Il se met en colère, les insulte. Le vieil ami de Raymond le laisse partir seul… “Moi, je l’ai suivi quand même”. Et c’est pure générosité. Camus est en retrait de son personnage lorsqu’il dit de lui qu’il “n’a jamais d’initiative”. Comment appeler alors la décision qu’il prend ici de suivre Raymond pour le protéger contre lui-même ? C’est en effet de manière consciente et très ajustée (comme de l’intérieur) à la mentalité de Raymond, à son langage (“Prends-le d’homme à homme…), qu’il l’amènera à lui abandonner son revolver et qu’il prendra ainsi sur lui le risque de s’en servir si la vie de son copain était mise en danger. Meursault aime-t-il Raymond plus que lui-même ? Que répondre sinon que le souci de soi ne limite pas son amitié ou que son souci de la vie est plus grand… Face à l’agitation impulsive et irrationnelle de Raymond, à son orgueil d’adolescent et de petit voyou, Meursault maîtrise lucidement la situation, il prend tout sur lui jusqu’à cet instant limite où il comprend que la réalité atteint à son point d’aléatoire et de vanité de toute maîtrise : “J’ai pensé à ce moment qu’on pouvait tirer ou ne pas tirer”. Les Arabes se retireront et Meursault ne tirera pas, mais il est à présent – pour avoir voulu éviter un meurtre – en possession d’une arme. La sympathie c’est donc déjà l’amitié sans limite. Au delà de Raymond, pour la vie même, ce que d’autres appellent son respect.
Le prêtre voulait purifier l’âme de Meursault, lui gagner l’éternité. Mais dans des bondissements mêlés de joie et de colère, “au sortir du tombeau” et de la terreur de la mort, comme le Christ ressuscitant de Piero della Franscesca, c’est de l’âme elle-même dont Meursault s’est définitivement purifié. Et par là de tout dualisme, de toute opposition de la conscience et du monde, du dernier obstacle au consentement et à l’amour universel qui est l’étoffe même des corps. “Où le bonheur naît de l’absence d’espoir, où l’esprit trouve sa raison dans le corps” la conscience, devenue pure phosphorescence de la nature entière, l’ouvre au présent, à la tendresse infinie du monde, pour la première fois dans la pure joie immanente du comprendre. Là où sentir, aimer, connaître, sont une seule et même chose, dans cet accord parfait au monde qui est aussi accord à soi-même et, malgré leur haine à tous les autres hommes. Absence d’espoir, fin de la crainte : “le contact direct, sans intermédiaire, donc l’innocence” a été retrouvée. Mais une “innocence au 2è degré”. Celle que permet la lucidité du vrai. Vérité éternelle de la volonté d’être et de persister d’une vie définitivement arrachée à l’involontaire et à l’illusion. C’est le moment de vérité dans lequel tout s’inscrit, “l’humanité et la simplicité. Et quand donc suis-je plus vrai que lorsque je suis le monde ? Je suis comblé avant d’avoir désiré. L’éternité est là et moi je l’espérais. Ce n’est plus d’être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d’être conscient”.
Souhaiter un changement de serviette plutôt qu’un changement de vie ; se faire avec plaisir des pommes de terres bouillies plutôt que faire carrière ; devenir silencieusement éternel et infini à sa place du sein de sa finitude et de sa propre prison, c’est le message sans espoir, mais non sans amour, laissé par Meursault. Une invitation à la plénitude, à la lucidité aride et à la joie des êtres libres et mortels. En proximité absolue de la vie comme de la mort, de la vérité comme du mensonge, son histoire essentielle tient à tout. Il n’était étranger à rien, sinon – mais il en comprenait aussi la contingence et la nécessité – aux tristes illusions des hommes. Laissons Meursault dans sa cellule de condamné à mort. On ne saura jamais s’il a été exécuté. Et sans doute, comme les mythes, l’histoire que raconte Camus est faite pour que notre imagination l’anime. J’aime à penser que le hasard des circonstances s’est renversé en la faveur du héros et lui a permis d’obtenir sa grâce et finalement sa libération. J’imagine alors Meursault, riche de la sagesse solaire à laquelle il a accédé – qui maintient en lui vivant le feu d’une vie sauvage et éclatante – écrivant sa propre aventure (il ne s’appelle pas Meursault bien sûr, et l’histoire que nous avons lue, tout en étant autobiographique, est bien un roman). Le texte de Camus et celui de M. sont certes verbalement identiques, mais le second – qui réalise déjà l’œuvre dont rêvait Camus, qui parlerait confiait-il, “d’une certaine forme d’amour” – est, sur le plan de l’expérience philosophique, infiniment plus riche, mais au fond guère différent. La différence qu’il y a entre l’envers et l’endroit.




